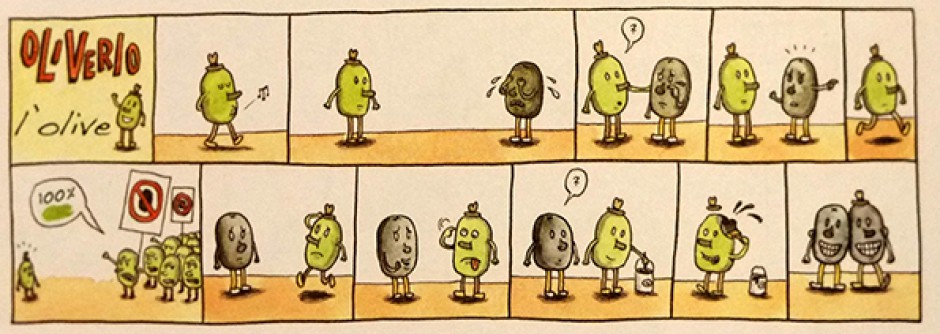Cette galerie contient 7 photos.
Quizz : quelle espèce de racialisateur es-tu ?
A propos du texte « Pour une approche matérialiste de la question raciale », du dossier sur la « race » publié par la revue Vacarme et, au-delà, de la sale racialisation que certains s’échinent à faire advenir.
« Dis-moi de quelle longueur de cuillère tu prétends être doté, je te dirai avec quel diable tu entends manger et quel sera celui par lequel tu te feras dévorer ». Dicton populaire traduit du yiddish
Tiens, ça glisse…
ou comment, à trop s’approcher de la race, on finit par tomber dedans (et son matérialisme avec)
par les Hiboux nyctalopes et le GLOCK (Grondement Libératoire de l’Offensive Communiste Kritik)
Le texte mis en page: Tiens_ça_glisse, version papier pour diffusion disponible.
« La race c’est pas classe, c’est la classe qui est classe ». Karl Marx, mot d’enfants dans un de ses cahiers d’écolier, Archives inédites
« La race c’est vincho, la lutte des classes c’est michto ». Adage gitan
« Tous ceux qui nous rebattent les oreilles avec la race sont des salopards qu’il faut déglinguer, par tous les moyens nécessaires ». Harangue d’un militant des Black Panthers en 1969, avant qu’il ne rentre à l’université
« C’est pas parce qu’on a mis le pied dedans qu’on doit y mettre les mains ». Hubert Félix Thiéfaine
« A force d’écrire des choses horribles, les choses horribles finissent par arriver ». Irwin Molyneux / Félix Chapel, Drôle de drame
Remarque préalable de vocabulaire : on appellera dans ce texte « racialisation » toute analyse contribuant à développer et à diffuser une théorie de la race. C’est le seul terme qu’on a choisi de conserver pour nommer ceux-là même qui, de « racisé » à « indigénisation » en passant par « blanchité », veulent en imposer toute une palanquée. Si un nouveau mot a paru nécessaire, c’est parce que l’existence publique d’une théorie de la race est elle-même, et sous cette forme, relativement nouvelle. Le racialisateur partage le monde en différentes races et nous assigne à tous une place dans ce partage. Parfois le partage est grossier : on est « blancs » ou « non blancs », parfois il est plus détaillé mais perd alors en cohérence. Si on ne trouve pas le moyen de refuser d’obéir à ces assignations qui se font passer pour des constats, on risque fort de se condamner à devenir ce dont ils nous prédiquent. Aujourd’hui, et sous nos latitudes, contrairement à ce qu’a pu être l’Amérique ségrégationniste par exemple, dont on importe les théories, le modèle et le vocabulaire, ce n’est pas l’État qui racialise. La diffusion actuelle de la théorie de la race est l’œuvre d’un courant situé à gauche, voire à l’extrême gauche, qui, tout en cultivant ses polémiques et contradictions internes, travaille à constituer ce qu’on peut appeler une « aire racialisatrice ». C’est pour contribuer à contrer ce mouvement que ce texte a été écrit.
Depuis quelques temps, il est de bon ton, il tendrait presque à devenir normal, dans différents milieux, plus précisément dans une couche de la gauche et jusque dans ses extrêmes, d’employer à tour de bras le terme « race » et ses dérivés aussi récents qu’approximatifs : « racisé, racialisés, racisations, racialisations ». Lors d’un meeting récent, on a pu entendre une intervenante de la tribune affirmer qu’elle pouvait désigner du doigt les « blancs » dans l’assemblée, « blancs » dotés de « privilèges », les opposer aux « non blancs », et, pour défendre la validité de la notion « d’intersectionnalité », défendre « l’obligation » de prendre en compte « la race » à laquelle « elle appartient », face à un public quelques fois critique, mais plus généralement atone, voire enthousiaste — « c’est vraiment chouette, ce qui se passe pour l’instant » entend-on commenter une « féministe matérialiste ». On peut donc affirmer, entre autres choses, qu’il y a des « blancs » et des « non blancs », que c’est ainsi que se partage le monde, et c’est chouette.
Ce changement est en premier lieu lexical puisque, la réalité du racisme et du sort particulier que le capitalisme, l’Etat ou ses agents, réservent aux migrants, aux sans papiers, aux travailleurs immigrés et à leurs descendants n’ayant pas notablement changé depuis l’année dernière, c’est bien au niveau des mots, qui sont importants[1] comme tous les racialisateurs le savent, que le changement s’est opéré. Le Parti des Indigènes de la République en est la principale cheville ouvrière. Son porte parole, Houria Bouteldja, d’ailleurs, le formule clairement dans son entretien avec la revue Vacarme[2] : « notre visée est de recomposer le champ politique à partir de la question raciale ». C’est effectivement ce à quoi les colporteurs du PIR s’appliquent, pour quelques uns depuis une dizaine d’années.
Entendons bien l’enjeu : il ne s’agit pas de proposer des analyses consensuelles. Ainsi, les déclarations agressives, clairement racistes, homophobes et antisémites, les invectives contre le métissage ou les dits « mariages mixtes » qu’ils profèrent ici ou là ne sont assurément pas là pour mettre d’accord. Recomposer le champ politique, c’est bien autre chose, et c’est aussi à coup de polémique que ça se passe : antisémite ou pas, homophobe ou pas, machiste ou pas, c’est bien de race qu’il s’agit de traiter. Ces appels à la haine et à l’inversion en miroir des valeurs et des présupposés racistes de ce qu’ils construisent comme « le monde blanc » ont longtemps sonné creux, sans doute aussi parce qu’ils étaient essentiellement portés par des universitaires ayant peu d’écho dans les luttes. Tout d’un coup, depuis une petite année, non seulement l’audience du PIR grossit (800 spectateurs, d’après les organisateurs pour fêter ses dix ans, certes sans doute réunis surtout pour voir Angela Davis) mais le prêt-à-penser qu’il refourgue est repris et approprié, avec son vocabulaire ignoble de la race décomplexée, par un champ large allant de la gauche la plus institutionnelle à des milieux militants plus radicaux. Et quand on ne reprend pas ces termes, du moins on n’y réagit plus et on ne s’y s’oppose pas. Cet état de fait ne vient pas d’un changement de composition de ceux qui sont à l’initiative de ces discours, ni à leur implantation dans des luttes ou auprès de quelconques larges masses. Il est, en revanche, certainement lié à la disparition de toute revendication d’autonomie politique et pratique et au manque actuel de propositions subversives. Là où le terrain s’est considérablement appauvri, il ne faut pas s’étonner qu’on ne puisse pas cueillir les meilleurs fruits. On peut aussi constater qu’une f(r)ange militante de gauche au sens très large s’en fait le relai. Face à cette situation, le fatalisme lui-même est intolérable.
Le dossier consacré par la revue Vacarme au thème de la « race », ainsi que ses suites, est révélateur de ce processus. Il aurait fait polémique à l’interne, il fallait bien pourtant parler de cette « sale race », comme ils affectent de dire. Cette nécessité tient sans doute à l’effet de mode, qui sur cette question et dans un contexte de crise et d’appauvrissement généralisé ne laisse pas de susciter la perplexité. Et, pour en parler, il fallait bien aller voir le PIR. Jusqu’ici universitaires, journalistes et travailleurs de la culture de Vacarme et du PIR, qui devaient bien se croiser dans les mêmes cercles institutionnels ou éditoriaux, n’avaient pas, semble-t-il, éprouvé le besoin de se rencontrer[3]. Aujourd’hui, c’est donc une nécessité. Ainsi, on pourra lire un dossier objectif dans lequel un entretien laissera percevoir l’ignominie de certains propos du PIR. On le critiquera ensuite de deux points de vue. De celui de l’universalité d’abord, ça, à Vacarme, on sait faire normalement, puisqu’« on est la gauche »[4]. Dans le numéro suivant, on invitera des « militants de terrains » (en l’occurrence des universitaires aussi, hors de l’université point de salut !), à le critiquer d’un point de vue qui se dit « matérialiste ». Ça, à Vacarme, on ne sait plus faire depuis longtemps, depuis « qu’on est la gauche » peut-être justement, c’est pour ça qu’on doit inviter d’autres contributeurs, qui — médaille du jour — sont « racisées » ou au moins racisables ou en tout cas se déclarent candidates à l’opération.
Ce qui nous intéresse ici, et nous pose sérieusement problème, c’est que, non seulement, quelles que soient les gesticulations et dénégations de détail, la démarche de Vacarme en publiant ce dossier correspond tout à fait aux objectifs clairement énoncés par Bouteldja (polariser le champ politique à partir de la question raciale), mais, plus grave, l’article qui y fait suite, sensé être le plus radicalement critique, Pour une approche matérialiste de la question raciale, tout en pointant les dérives et exagérations incontournables du PIR (antisémitisme, sexisme, homophobie), avère tranquillement l’idée qu’il faut penser avec la race et, parce qu’on est encore sans doute un certain nombre à savoir que la race, ça n’existe pas, ses dérivés « racisés », « racisation », etc… ainsi que la notion d’« indigènes » auxquels on peut ajouter le cache sexe « sociaux » pour faire bonne mesure en terme de sociologie marxisante. Penser avec la race devient un impératif incontournable : tout refus de ce vocabulaire et de ce qu’il charrie sera systématiquement considéré comme de la dénégation, voire du déni, et tombera sous le coup du dispositif accusatoire.
Ce texte, qui devrait plutôt s’intituler, comme on le verra, « pour une approche racialiste du matérialisme », contribue donc à construire ce qu’on pourrait appeler le champ de la racialisation, consacrant par là-même la réussite des premiers objets affichés de sa critique. Sur ce champ, deux positions se retrouvent à s’affronter : la race seule contre la race « articulée », en l’occurrence à la classe, et au genre, indispensable partenaire actuel de toute moralisation. Pour tous ceux qui entendent bien refuser de se laisser imposer le constat terrible que « tout nous ramène à la question raciale », et parce que justement le texte qui assène ce constat se présente comme « une réponse matérialiste au PIR », il est de première urgence de le lire avec attention et de le critiquer sans appel. C’est ce qu’on se propose de faire ici, sans prétendre avoir été exhaustif.
Où l’on commence à accepter les termes du débat
Parce qu’un texte prend aussi sens dans le contexte discursif dans lequel il s’inscrit, examinons rapidement le dossier auquel il répond. La manière dont il est introduit ne laisse pas de doute : il ne s’agit pas de trancher (on « est la gauche » mais on est aussi « des militants de l’incertitude »[5], à Vacarme…). « La race n’existe pas mais elle tue », pourquoi pas. L’avantage du paradoxe et de l’aphorisme, c’est que ça dit beaucoup à la fois. Mais quand on fait des phrases claires à propos du PIR, ça donne : « il nous semble dans ce contexte d’autant plus important d’être capable de nous parler, ne serait-ce que pour que chacun sache à qui il parle, et mesurer les profonds désaccords qui nous séparent, certains irréconciliables, d’autres non. » L’important est donc de maintenir le dialogue et de faire la part des choses, on ébarbera ce qui dépasse — les provocations outrancières de Bouteldja sur le métissage, l’homosexualité et les rapports homme-femme sont effectivement insoutenables —, mais on ne s’attaquera pas à l’essentiel et on contribuera à valider ce qu’on peut appeler aujourd’hui une théorie de la race qui est bien, au contraire, ce qui devrait, à minima, faire « froid dans le dos » à tous ceux qui applaudissent des deux mains.
Faisons une petite pause et rendons nous compte de ce qui se passe : il faut donc aujourd’hui penser à plusieurs intellectuels de haut niveau, convoquer des « militants de terrain » et produire un dossier de plusieurs dizaines de pages pour finir par avancer courageusement qu’être ouvertement antisémite, machiste et homophobe pose problème. On peut à juste titre se demander où en sont la gauche et ses radicaux (et par quoi est traversée l’université).
Au contraire, nous pensons que face à cette tentative d’OPA discursive portée au départ par une f.r.ange restreinte d’universitaires hors-sol, qui tentent d’imposer le retour à des catégories dont chacun sait (que ce soit à travers le savoir de l’histoire ou l’expérience des luttes, — à ce niveau-là, regarder la télé de temps en temps suffit même sans doute d’ailleurs) qu’elles sont intrinsèquement et irrémédiablement ségrégationnistes, qu’au lieu de construire du commun, elles séparent et ne portent qu’assignation, perspectives communautaristes, ressentiment, culpabilisation et haine de soi et des autres, c’est un front du refus qu’il faudrait construire.
On pourrait répondre à juste titre qu’un contexte de conflictualité sociale plus intense balaierait ces sales manières de voir le monde, rendues alors finalement à leur vanité. C’est vrai, mais on sait tous que ce n’est pas actuellement le cas. Il va donc bien falloir, sauf à se laisser engloutir sous les immondices de la théorie de la race, s’opposer activement à la propagation de la grille d’analyse racialisatrice.
Voilà bien ce qui est pour nous, militants auxquels, en l’occurrence, les luttes aux côtés des sans papiers et des immigrés, travailleurs ou pas, ont appris que nous ne sommes ni blancs ni non-blancs, « une question d’auto-défense » politique. Pour cela on se propose ici à la fois d’observer les formes que prend cette propagation de la théorie de la race puis les enjeux de son refus, surtout quand elle s’affuble d’un voile matérialiste.
Contre la racialisation du matérialisme
Le texte, dont le titre complet est Pour une approche matérialiste de la question raciale, une réponse aux Indigènes de la République, s’inscrit dans un processus de rejet du moins assumable et de normalisation de ce qui est pourtant au centre de la théorie du PIR. Il s’agit de faire du matérialisme un outil sociologique, un « garde fou » verbal, une toile de fond sur laquelle le projet est d’inscrire la race. Le sous titre est d’ailleurs éclairant : « répondre aux Indigènes », c’est accepter l’interlocution, c’est valider la nécessité d’un débat et le terrain sur lequel il se mène[6].
Venons-en au texte lui même. Même si elles peuvent sans doute tomber sous le coup de diverses critiques, les deuxièmes et troisièmes parties font preuve d’une certaine clarté et d’une relative fermeté face à l’antisémitisme, à l’homophobie et au sexisme du PIR. Tant mieux, c’est d’ailleurs ce qui fait le succès de ce texte chez ceux qui cherchent à s’opposer à la crête de la vague racialisatrice.
Le problème reste que le ver de la race est déjà ici dans le fruit, tout « matérialiste » qu’il prétende être. Et c’est dans la première partie que la magie s’opère, première partie qui ne reste peut-être pas en mémoire du lecteur rapide qui cherche surtout des arguments contre le PIR et croit à ce pour quoi ce texte se fait passer : une réponse matérialiste sans concession aux thèses du PIR. La réponse du PIR d’ailleurs contribue à l’instituer à cette place[7]. Pourtant, qu’ils soient pour une suprématie absolue ou relative de la race, la querelle entre racialisateurs « matérialistes » ou non institue en tous cas le champ de la racialisation. C’est donc à la critique de cette première partie du texte qu’on va principalement s’atteler, en ce qu’elle valide le recours nécessaire à la théorie de la race, qu’il faudrait cependant nettoyer de ses aspects les plus gênants. Examinons donc cette proposition d’une « race à visage humain », cette « race matérialistement correcte », pourrait-on dire.
Puisque c’est d’abord de mots qu’il s’agit, faisons un petit tour de vocabulaire. On observe dans le texte, clairement utilisé de manière positive, le champ lexical de la race. Voilà qui donne le ton. On peut y lire : « les questions raciales », « la question raciale » (à laquelle « tout nous ramène »), « les racismes » (on verra plus bas comment cet étrange pluriel est une manière de valider la race comme notion opérante), « les racisés » (bien sûr, dont on reparlera), « le racisé », « les prolétaires racisés », « les hommes racisés », « la question raciale », qualifiée cette fois de « plus centrale », « la question de la race est centrale », la savoureuse « prime raciale à l’exploitation », puis, au cœur de cette partie du texte, ça y est, après la « racialisation » ou la « racisation », la « race » existe et elle est centrale : « envisager la race comme une construction sociale… » (on verra le caractère pernicieux de cette histoire de « construction sociale » appliquée à la dite race, contentons nous pour l’instant d’observer que la race est bien là, à côté du genre et de la classe), « articuler race et genre, race et classe » et le plus beau, pour conclure, « la lutte de race » qu’il faut « articuler » bien sûr avec « la lutte de classe » (on n’a pas mis de pluriel à « classe », sans doute parce que la symétrie qui deviendrait nécessaire avec « lutte des races » aurait rendu le caractère monstrueux de la proposition trop apparent).
En plus du tapis rouge déroulé au vocabulaire de la race, le texte utilise sans pincettes les expressions nauséabondes que le PIR essaie d’imposer sans succès depuis une dizaine d’années (sans succès, c’est-à-dire en l’occurrence dont personne n’avait besoin : l’employer est donc un choix) : « les indigènes », puis « les indigènes sociaux » d’abord avec des guillemets et précédé de « les fameux », donc cités du langage du PIR, puis utilisé normalement « une indigène sociale » à la fin du texte, sans guillemets, ni « fameux », le surprenant « indigène mâle » (qui fait couple sans doute avec l’« indigène sociale »), « la gauche blanche », « les féministes blanches », « le féminisme blanc », « face au racisme des Blancs » (on savoure la subtilité toute matérialiste de la majuscule), « les privilèges » des « blancs », « les Blanches du 93 » (sans doute un groupe d’auto-défense de classes moyennes sur le modèle des Blacks Panthers, dont l’existence nous aurait échappé). Pire encore peut-être, le texte reprend, l’expression « mariages mixtes » pour reconnaître que ce sont toujours des mariages « entre dominants et dominés ». On espère que ceux qui sont catégorisés ainsi ne seront pas les seuls à se scandaliser d’un tel regard et que ce terrorisme discursif contre le métissage sera pris pour ce qu’il est.
Alors, bien sûr, tout ça doit « s’articuler ». Mais il n’en reste pas moins que ce texte affirme, et avère, que « tout nous ramène à la question raciale ». Or, il se trouve justement que la race s’est toujours donnée sous la figure d’un constat indépassable, du moins depuis qu’elle existe comme système théorique constitué, c’est-à-dire depuis le XIXème siècle (ses premiers balbutiements sont venus plus tôt par exemple au service de la justification de l’esclavage, sans avoir pour autant les mêmes aspirations totalisantes). Sauf perversité particulière, c’est toujours à contre cœur qu’on adopte un système de pensée raciste, c’est toujours parce que le monde est ainsi fait. A l’époque du positivisme triomphant, la nécessité de penser avec la race s’établissait par le biais de la science : les races, on était bien obligé de les constater scientifiquement en mesurant les squelettes, la position des arcades sourcilières pour organiser une typologie des faciès, et la taille des cerveaux. Pas besoin d’avoir beaucoup de mémoire pour savoir que depuis, et pour de fort bonnes raisons, universalistes ou pas d’ailleurs, quasiment tout le monde en est revenu. Aujourd’hui, dans ce texte, c’est à nouveau une nécessité, liée désormais aux processus économiques, politiques et sociaux (sociaux surtout, les sociologues ne font-ils pas les meilleurs « activistes » ?) qu’on veut nous vendre. Or, si penser avec la race est justement un choix qui s’est toujours présenté sous le visage d’une nécessité, c’est peut-être parce qu’il est, en tant que tel, indéfendable.
Ceci dit, qu’il soit bien entendu qu’il ne s’agit pas d’une querelle terminologique. Penser avec la race, employer les termes qui en découlent, est une proposition de vision du monde. La question, ou la solution, n’est d’ailleurs pas de ne plus employer certains termes, ou pire de les rendre tabous, mais bien de comprendre de quoi ce vocabulaire récent est le symptôme et ce qu’il contient comme proposition politique. A l’opposé de la démarche de Vacarme, c’est cette vision du monde, cette proposition politique, qu’il s’agit ici de contribuer à mettre en échec.
Penser avec la race ?
Alors, penser avec la race, quand on se dit « matérialiste », qu’est-ce que ça peut bien donner ? D’abord un appauvrissement terrible de la lecture des événements politiques (d’ailleurs systématiquement considérés comme des « phénomènes sociaux »[8], ce qui est déjà un choix particulièrement anti-subversif). Dès le début du texte, deux exemples sont donnés pour justifier (et défendre) la centralité de la race : les morts des migrants en Méditerranée et les émeutes de Baltimore[9]. Dans les deux cas, c’est bien en fait à une question de classe qu’on est assurément confronté. Pour ce qui est des émeutes de Baltimore, y compris en prenant en compte le contexte américain très particulier, il est évident, sans avoir besoin de rentrer dans de confuses considérations sur la justice ou l’assassinat policier de rue à deux vitesses, que ceux qui ont été tués par la police étaient bien des prolétaires, et que c’est même parce qu’ils étaient des prolétaires que la police les a tués. D’ailleurs, s’il était nécessaire que cela soit pensé et formulé par d’autres, un certain nombre d’acteurs sociaux locaux et de terrain (pour reprendre le vocabulaire de sociologue en quête de mission) l’ont déjà rappelé, y compris dans des médias ayant une grande audience[10]. Un racialisateur « matérialiste » averti pourrait d’ailleurs s’étonner que ce ne soient pas des traders (pour rester dans des catégories intéressantes), fussent-ils of color, qui soient morts. Or, alors que c’est bien une question de classe qui se pose directement ici, le texte appuie la lecture la plus superficielle, celle qui consiste à convoquer la race. D’ailleurs, dans ce système de pensée, que raconte l’illustration montrant des « juifs » portant des kippas (signes religieux, s’il faut le rappeler) manifestant, avec sa légende[11], si ce n’est la projection d’un paradis racialiste, avec une solidarité inter-raciale affichée comme telle. Au passage, nous remarquons que, de l’émeute, on est passé à la manifestation, qui permet de faire sa place à la mise en avant des identités et donc à l’expression d’une indignation interclassiste dans un cadre pacifié. A ce niveau, n’en déplaise aux tenants de la théorie de la race, toutes obédiences confondues, projeter des lectures raciales ne contamine pas encore efficacement la réalité, et, partant, des modes de lecture opérant les tiennent encore intellectuellement facilement en échec.
Concernant la question migratoire, outre le fait que l’aborder uniquement sous l’angle des « morts en Méditerranée », c’est se borner à adopter précisément le point de vue du scandale médiatique (un mort toutes les 2 heures nous dit la presse) alors que ce qui se joue là est beaucoup plus terrible, riche et puissant que cette métonymie pauvrette et victimaire. Pour que cette question nous ramène « à la question raciale », encore faudrait-il, sinon c’est un peu court, déterminer de quelle race pourrait bien être les migrants (peut être que nos chercheuses, inspirée des États-Unis, ont un projet, en quête de financement, qui permettrait de généraliser massivement des tests ADN à cette fin ?). Quels rapports, quelle « articulation », si chère à nos matérialistes de papier, pourrait-on bien établir entre le fait de passer les frontières illégalement et massivement, malgré les difficultés, les coûts de tous ordres et les risques de toutes natures et la « race » ? En quoi le fait que des prolétaires extra-européens se mettent en danger pour passer des frontières qu’ils ne peuvent prétendre passer légalement, nous ramène-t-il « à la question raciale » ? Choisir cet angle pour lire les assauts, réels et symboliques, que mènent tous les jours des migrants contre les frontières est vraiment à côté de la plaque, surtout au moment où ces passages de frontières font l’objet du déploiement de l’attention médiatique, de nombreuses déclarations et d’actes de contrôle et de répression, d’actes de guerre. A côté de la plaque, mais aussi très grave. Ces événements et les acteurs qui en sont partie prenante, appellent autre chose, de la part de « communistes » que d’être renvoyés à cette assignation et à l’horizon ségrégationniste qu’il promet. Ceux qui ont réussi à passer la frontière, après les passeurs, les flics européens, les coups de matraques socialistes, méritent mieux qu’un tel coup de pelle théorique sur la tête. Pour ébaucher une autre manière d’en parler, on peut dire par exemple que le sort des migrants est bien plutôt le résultat de l’affrontement entre la force réelle de la migrance et le projet de gestion par le système capitaliste des flux de main d’œuvre incarné de manière variable par les politiques mises en place à l’échelle des états et d’ensembles plus vastes comme Schengen (et non par un quelconque « système raciste »). Si l’on passe par le cas français d’ailleurs, il est clair que la politique mise en œuvre en général, et en particulier pour gérer les migrants, n’est pas raciale. Comprendre cette politique au niveau européen par exemple passerait plutôt par le renouvellement des analyses qui ont pu être proposées il y a plus de 10 ans, qui mettaient en tension le discours sur la fermeture des frontières (accompagnée des spectaculaires et vaines constructions de murs et mises en place de barbelés) avec la réalité des pratiques étatiques et d’exploitation à l’encontre des migrants. Ce discours de « l’Europe forteresse » accompagne en fait l’exploitation d’un volant de main d’œuvre corvéable à merci nécessaire à plusieurs secteurs comme le bâtiment ou la restauration, et maintenu dans des situations fragilisées (titres de séjours d’une durée très courte, sans autorisation de travail, clandestinité ou légalisation du séjour suspendue à la durée du contrat de travail). Au-delà de ces points de vue donnés rapidement pour l’exemple et évidemment aujourd’hui sans doutes dépassés, quel peut bien être ce regard qui réduit la puissance de la migrance et les situations évidemment politiques qu’elle suscite (comme celle des migrants de la Chapelle à Paris par exemple), sous le jour de la race ? A quel genre de pratique de solidarité ce raisonnement (qui n’est de fait ici lié à aucune pratique ni à aucune solidarité) nous inviterait-il, si ce n’est à un paternalisme culpabilisé et finalement sur fondement inter-racial, donc raciste ? En effet, puisque, selon ce point de vue, les migrants sont d’une race et une grande partie des militants d’une autre, c’est ça qui fait de chacun un sujet politique, un « sujet de race » en somme et c’est sur ces identités que se fonde l’interaction.
Pour toutes ces raisons, la lecture en terme de race est tout bonnement aussi bien ahurissante qu’abjecte. Par quel tour de passe-passe nos idéologues de la race s’autorisent-t-elles à faire tomber les migrants et ces affrontements de classe dans une escarcelle aussi nauséabonde ?
Quant aux autres « menus faits quotidiens de la vie métropolitaine »[12], qui eux aussi nous ramènent « à la question raciale » (décidément, dans ce discours qui fonctionne par saturation plus que par démonstration, la réalité est en passe de se retrouver complètement racialisée), il faudra sans doute attendre la suite de la production de nos communistes tout terrains pour savoir de quoi il est question. Quel dommage, pour le lecteur avide d’explications simples, de ne pas avoir pu proposer quelques éléments, même fugitifs et éthérés ! Penserait-on ici aux expulsions de sans-papiers ? Ou, pour rester à proximité des transports, à la destruction par des pelles mécaniques d’un bidonville de Rroms sur les contreforts d’une autoroute ? Ou encore à ce qui se passe dans le métro ici où là quand un immigré est chargé de nettoyer la nuit les couloirs ? Ou même dans le bus quand un fraudeur en jogging prend une amende ? On se perd en conjectures mais, sans les lumières de nos drôles de matérialistes, on ne voit pas bien de quoi « ces menus faits » de la « métropole » sont constitués, ni en quoi ils nous ramènent, eux aussi, à la « question raciale », avec laquelle on aimerait nous rendre familiers.
Plus bas dans le texte d’ailleurs, quand les auteures se mettent à prendre le RER, on trouve un petit passage qui concerne les jeunes et la sortie de l’école. On peut y lire là aussi à quel recul théorique on peut en arriver. A cause du « racisme intégral consubstantiel à la société française », affirment nos économisées de la politique, (mais opérant seulement à partir du milieu du collège[13]), ceux qu’on ne considère que comme des « racisés » vivent une « ségrégation », que le texte dénonce, démontrée par leurs difficultés pour trouver des stages ou un « job » en sortant de 4ème. On revient à une analyse du même type que celle d’SOS Racisme dans les années 90 (d’ailleurs, juste après, on a l’immanquable « racisé » refoulé à la porte des boîtes de nuit, figure promue, via les « testing », comme préoccupation centrale de cette officine du parti socialiste) : le problème, c’est la discrimination.
La capacité à parvenir, dans le cadre de la réussite minable proposée par le capitalisme, devient un critère de constitution de cette espèce de « sujet de race ». Quand on sait que l’école a toujours été le lieu de l’adaptation de la main d’œuvre aux besoins du capital, quand on sait ce que sont les stages en question, en terme de domestication et d’accoutumance aux conditions de travail merdiques aujourd’hui proposées massivement aux jeunes issus des classes populaires, quand on se rend compte de ce que signifie « orienter » aujourd’hui, surtout en fin de 4ème d’ailleurs, mais pas seulement, il y a bien de l’analyse marxiste et politique qui se perd ici, et que cette dénonciation en terme de discrimination enterre.
La légèreté conceptuelle qui conduit, à partir de ces quelques exemples, sans aucune analyse, à imposer sous la figure de l’évidence la nécessité de la lecture raciale, est véritablement inquiétante : si « tout nous ramène à la question raciale », sans aucun raisonnement, c’est qu’il y a là un parti pris de départ, le parti pris qu’il faut adopter la race comme grille de lecture, sans pour autant en assumer les présupposés ni les implications.
A l’inverse de construire un raisonnement montrant en quoi « la race » est partout, affirmer devient prouver. On nous assène comme une évidence que « certaines luttes sont massivement racialisées », selon les chiffres de l’Institut Racialisateur du Temps Présent, sans doute. Comme dans une boucle, on arrive là d’où on est parti : l’hypothèse de départ — produite ex-nihilo — se fabrique sur elle-même magiquement. Ce matérialisme frelaté propose donc en fait une racialisation de contrebande.
A partir de là, il devient clair qu’à côté des désaccords, d’importance mais ponctuels, avec les aspects polémiques du discours du PIR, le texte exprime bien un accord fondamental autour de la nécessité de la lecture raciale. D’ailleurs, quand c’est le point de vue du PIR qui est critiqué dans son ensemble, il l’est parce qu’« il propose une lecture systématiquement culturelle voire ethnicisante des phénomènes sociaux. Cela l’amène à adopter des positions ”dangereuses”, [dangereuses pour qui, sinon qu’elles compliquent la tâche de ceux qui entendent diffuser la théorie de la race ?] sur l’antisémitisme, le genre et l’homosexualité ». En somme, pas de problème avec la lecture raciale, un refus de la lecture « culturelle et ethnicisante » et au passage le retour de la vaseuse notion de « phénomènes sociaux » pour, sans doute, parler de politique ou de conflictualité. Outre le fait qu’on ne comprend pas vraiment en quoi la lecture « culturelle et ethnicisante » mène directement à l’antisémitisme, au sexisme et à l’homophobie, y compris quand elle est systématique (bien des associations culturelles qui ne proposent que cette lecture prônent au contraire une tolérance interculturelle, y compris dans des perspectives très dépolitisées), cette phrase dédouane la lecture raciale qui est bien au contraire le ferment d’origine justement des trois « glissements » mentionnés (« le PIR a glissé », sic, mais où pouvait-on bien cheminer pour se trouver si vite, en glissant, dans des eaux si boueuses ?).
Constatons au passage d’ailleurs que l’antisémitisme, le sexisme et l’homophobie, c’est-à-dire le racisme amélioré du PIR, se retrouvent dans l’opération réduits au statut de « glissement », quasiment des lapsus, au sens propre, en somme, qu’il faut pointer du doigt, en proposant ce qui serait une lecture soft, refoulée, de la race, donc un racisme visiblement ni antisémite, ni sexiste, ni homophobe, un racisme civilisé.
La plupart du temps, c’est effectivement une théorie de la « race molle » qui est proposée ici. Sont critiqués « les intellectuels radicaux » (radicaux de la race donc), au nom d’une race plus policée. Articuler race et classe c’est un peu comme sortir la race de sa radicalité : voilà déjà un projet alléchant. Mais le ton se fait plus ferme par moment, et pour critiquer le PIR très étrangement… par sa droite : « On [pour le PIR] drague la gauche blanche en rejouant ses tactiques historiques de minimisation du racisme. » De la gauche du PIR à sa droite, de la radicalité racialisatrice à l’usage moralisant de la classe, on slalome allègrement sur le champ de la racialisation… c’est chouette, mais qu’est-ce que ça glisse !
A propos des émeutes de 2005. « Les jeunes émeutiers issus de l’immigration étaient en proportion exacte de leur importance dans la population des quartiers qui se sont révoltés, ni plus, ni moins », nous apprend le texte. En voilà des sauvages bien élevés qui, pour mettre les banlieues en feu et provoquer des situations insurrectionnelles, se sont répartis en proportion exacte de leur présence dans ces mêmes banlieues (entre « issus de l’immigration » et prolétaires « autochtones »), en voilà un beau cadeau pour les statisticiens (et c’est charitable de la part des émeutiers, jeunes forcément – ne serait-ce pas l’usage immodéré de théorie qui fait vieillir prématurément ? – d’avoir fait ainsi la preuve que ce qui compte par dessus tout, c’est leurs origines, ils ne pouvaient pas mieux s’y prendre, voilà qui est gentil pour nos racia-matérialistes). Plus sérieusement on peut se demander qui connaît la composition sociale précise des émeutes de 2005 (s’il s’agit de celle des interpellés, c’est déjà tout à fait autre chose…), à moins que les premiers intéressés n’aient formé un institut exhaustif d’auto-enquêtes de masses, ou qu’un ministère du soulèvement des banlieues et des anciens émeutiers ait versé une pension à tous les anciens combattants (avec fichage racial intégré). Une note nous révèle que les informations citées sont tirées d’un article du Parisien reprenant un rapport des renseignements généraux : là aussi, à défaut d’enquête, on a les sources qu’on peut et on leur fait dire ce qu’on veut. D’ailleurs, est-ce vraiment à propos de la « composition raciale des émeutiers » que les émeutes de 2005 doivent nous questionner ? Réfléchir à comment de la conflictualité, de l’affrontement, de la politique a eu lieu dans des formes dont nous méconnaissons largement les spécificités ne serait-il pas plus pertinent et fécond ? En particulier quand, comme nos valeureuses auteures, on « milite dans différents groupes » ?
Et la race devient l’alpha et l’omega de la théorie…
Ce choix, inassumé comme tel, nous amène au point le plus problématique de ce texte : au-delà de son objectif avoué (s’adresser au PIR pour suggérer d’ajouter du point de vue de classe dans sa lecture de race), c’est bien plutôt à ceux dont la lecture de classe ne serait pas encore « racialisée » que le texte entend faire la morale : « Nous pensons donc qu’on ne peut pas comprendre le contexte actuel de paupérisation généralisée et de crise en faisant l’économie de la question raciale et d’un point de vue féministe ». C’est cette articulation-là qui est imposée in fine par le texte : mâtiner le point de vue de classe avec de la race. Les auteures partagent le même objectif formulé plus clairement par les rédacteurs de la revue Période quand ils affirment : « Il faut définitivement se débarrasser des approches des classes sociales qui passent outre les considérations sur la race »[14]. Le produit conceptuel est ici plutôt vanté pour réduire la place de la race, l’articuler convenablement avec classe et genre pour obtenir une moralisation optimale, sans outrance, « normale », en somme. Peut-être devrait-on donc exiger simplement d’ailleurs l’étiquetage adéquat qui ne trompe pas le consommateur, qui préciserait le pourcentage de race présent dans la théorie, et les traces éventuelles de racisme. En cas d’allergie, on pourrait ainsi s’en abstenir.
Ceci étant dit, les expertes semblent conscientes que deux écueils les guettent dans l’opération : d’abord la déviance dans la théorie de la triple oppression, véritable hérésie pour toute orthodoxie marxiste (et une inconséquence lourde pour tout marxiste conséquent d’ailleurs) puisque le capitalisme n’est plus pensé comme un système et se trouve réduit au rang d’une oppression parmi d’autres, chacune ayant son antidote. On mettra donc sur le même plan l’anti-capitalisme, l’anti-sexisme et l’anti-racisme (ce qui ne pose pas les mêmes problèmes que la théorie de la race, puisque ça devrait même être strictement son inverse, voir encart Race, racisme, racismes), et la proximité avec l’extrême droite (tiens, décidément le terrain est glissant). Pour ce qui est du premier, la magie de l’articulation doit nous en prémunir. Articuler « race et genre, race et classe », ce serait finalement ne pas les juxtaposer, ni « subsumer » genre et classe sous la race (hérésie de la triple oppression ou « glissement » du PIR). Aucune précision de ce en quoi cette articulation peut bien consister, et au final, une juxtaposition des notions, avec de la race strictement partout, dans le genre, dans la classe. On est dans quelque chose comme le mystère de la sainte trinité.
A y lire de plus près pourtant, une espèce d’approche théorique plus spécifiée, même si elle n’est pas toujours cohérente, se précise par moments, qui place le racisme à de drôles d’endroit par rapport à l’orthodoxie revendiquée. La racialisation est présentée comme une « dynamique essentielle du capitalisme », c’est un « phénomène structurel massif », puis plus bas, « le racisme est le régime d’exploitation matériel qui a organisé le capitalisme européen ». Il faut d’ailleurs penser « un racisme systémique », une « segmentation raciale » du prolétariat et c’est ça qui permet l’articulation. D’ailleurs à la fin du texte « il n’est pas possible de penser la classe sans penser la race et vice versa ». La race devient alors l’ingrédient nécessaire et principal pour penser la classe, et partant toute possibilité de transformation sociale. Dans cette approche qui fait de la race une « naturalisation » qui « colle à la peau », tout devient une assignation, y compris la classe elle-même.

Photos et légendes extraites de Races, belles illustrations d’une époque, 1930, où la race était une catégorie de pensée évidente et nécessaire… ce regard porté sur le monde, le monde nous l’a bien rendu.
Quel est le moteur de l’histoire ? Qui va-t-elle laisser sur le côté ? Qui se prépare-t-elle à écraser ?
Examiner un tout petit peu cette proposition revient à reconnaître qu’elle fait du racisme le moteur de l’histoire. Voilà un matérialisme sacrément rénové… D’ailleurs « Seule une lecture réellement matérialiste de la question raciale, et non une lecture simplement morale, comme celle de la gauche, ou politique, comme celle du PIR, nous permet d’articuler les différentes formes de racisme entre elles », ce sont donc ces racismes (voir encart Race, racisme, racismes) qu’on articule en pensant la race de manière non morale (contrairement à la gauche) et non politique (contrairement au PIR) : cette proposition, en cela conforme à l’époque, est aussi une perspective de dépolitisation…
Race, racisme et racismes. Les races n’existant définitivement pas, il semble assez évident de définir le racisme comme le fait même de considérer qu’elles existent et de voir le monde à travers elles. Ainsi, comme on peut dire que le barbare, c’est d’abord celui qui croit à la barbarie, on pourrait dire que le raciste, c’est d’abord celui qui croit à la race. Or la perversion étrange à laquelle on assiste consiste à inverser cette définition simple : la première étape de tout anti-racisme véritable serait la reconnaissance de la pertinence de la race, comme l’affirme l’article « Pour déracialiser, il faut penser avec la race (et la classe) » dans la revue en ligne Période. On marche donc sur la tête, et la racialisation — c’est ainsi qu’on propose d’appeler cette nouvelle manière de diffuser la théorie de la race au nom de l’anti-racisme — voudrait imposer son chemin. Quelle que soit la hiérarchie des races proposée (et la juxtaposition des races elle-même en est déjà une promesse), toute théorie de la race reste fondamentalement raciste. C’est un autre emploi néologique qui vient d’ailleurs brancher à l’envers l’anti-racisme sur la race : l’emploi de « les racismes ». Ce pluriel, qui essentialise la variété des incarnations que peut adopter le racisme chez les uns ou les autres, permet ensuite la déclinaison de plusieurs racismes, en général la négrophobie, la romophobie et l’islamophobie, l’antisémitisme se retrouvant volontiers oublié dans les énumérations : à chaque « race », son racisme; s’il y a plusieurs racismes, alors il y a bien des races. Si être anti-raciste c’est s’opposer « aux racismes », c’est donc aussi avérer l’existence des races, et les mettre immédiatement en concurrence.
Si on politise trop la race effectivement on tombe sur le deuxième écueil, qui n’est pas des moindre, celui de frôler l’extrême droite. De celui-ci on se prémunit par une autre magie, sans talisman cette fois. On se contentera de quelques affirmations : on propose « une critique conséquente de l’invisibilisation des questions raciales et de genre, échappant au grand jeu identitaire de l’extrême droite, ancrée dans la critique de l’économie politique ». Sans doute est-ce la critique de l’économie politique qui garantit d’échapper au « jeu identitaire de l’extrême droite ». Or nous pensons qu’aucun garde-fou verbal ne peut prétendre nettoyer la théorie de la race de sa nature profondément identitaire, naturellement morale, intrinsèquement ségrégationniste, bref fondamentalement raciste. Pas d’angélisme possible : l’horizon de toute théorie des races est leur mise en concurrence, leur guerre ; au fond qu’est-ce d’autre que cette « lutte de race » proposée à la fin du texte ?
Plus généralement, que fait le texte d’ailleurs sinon tripatouiller les « identités » et les mettre en concurrence, comme le PIR, avec cette pyramide des discriminés plusieurs fois invoquée (les noirs, puis les arabes et enfin, en haut, les blancs : « Il suffit d’observer un chantier de BTP pour constater qu’en général les gros travaux sont fait par les Noirs, les travaux plus techniques par les Arabes, et que les contremaîtres sont blancs. ») ? Quel besoin par exemple, lorsqu’on constate que des prolétaires immigrés issus de parcours migratoires différents mais se retrouvant dans un commun statut d’exploités, s’unissent pour lutter, comme le fait le texte à propos des « coiffeuses ivoiriennes » rejoignant les « sans papières chinoises », d’y injecter la « question raciale » ? Le texte invoque comme raison leur situation administrative commune, en l’occurrence l’absence de papiers. Quel rapport avec la race ? Devrait-on se féliciter de l’inter-racialité de cette lutte ?
La lecture proposée renvoie les acteurs de cet épisode, malgré le commun constitué dans la lutte, à une possible (et nécessaire) ségrégation.
Trouvez la rouge, suivez la noire : quelles règles pour le bonneteau racialiste ?
La race, d’ailleurs, à toutes les époques, est une notion aux contours finalement très vagues (puisque, comme chacun le sait, elle n’existe pas), qui sert à brouiller les catégories en les constituant. Elle devient ainsi le réceptacle des projections fantasmatiques les plus graves. L’emploi actuel du terme le confirme et ce texte le montre parfaitement, qui l’utilise pour désigner une vague origine migratoire, un type de « faciès », une nationalité (congolais, chinois), une couleur de peau, voire une religion (si c’est une « question raciale » que pose « l’islamophobie », c’est qu’être musulman, c’est finalement appartenir à une race[15]), à quoi on peut encore ajouter le jeu subtil des majuscules, dont on affuble de manière instable et avec des valeurs variées « Noir », « Arabe » et « Blanc ». Le tout s’appuie sur des enquêtes qui n’ont pas grand chose d’ouvrières, même pas vraiment sociologiques : « en général les gros travaux sont fait par des Noirs », ou d’étranges statistiques, sans doute mal comprises (voir encart A propos des émeutes de 2005). Comme au bonneteau, on fait apparaître, ou disparaître à loisir telle ou telle identité, selon les besoins projectifs. On remarque d’ailleurs que, dans la plupart des projections racialisatrices, les asiatiques, indiens, pakistanais, etc, sont absents des exemples et raisonnements (ici on a, pour se démarquer sans doute de cette tendance, les « sans papières chinoises », comme le PIR a fait dernièrement une place aux Rroms : à chacun ses cautions), sans parler du fait que les européens du sud ou de l’est sont plus logiquement classés comme « blancs » et à ce titre postulent difficilement au statut enviable de « racisés ». Si la race est un très bon support aux expérimentations identitaires, c’est bien parce qu’elle permet tous ces amalgames, et, en prétendant sans doute, comme le PIR, « retourner le stigmate », on ne fait que les approfondir. Alors que, dans ce monde, les prolétaires sont tous rendus justement étrangers à leur propre situation, dépossédés, on les englue ici dans des assignations identitaires qui « collent à la peau », on les enferme en les séparant entre « prolétariat autochtone » et « prolétaires racisés », on renforce la segmentation par de la défiance, et on condamne les uns et les autres, au mieux, à un horizon communautariste.
Quel intérêt de classe peut on trouver à se vivre comme une race ?
Car enfin, qu’est-ce que la race, sinon une construction, non pas sociale comme le prétend le texte (la race n’est ni le genre, ni la classe), mais idéologique, politique ? La race constitue, à partir de caractéristiques variables selon les cas (et sans aucune assise matérielle, faut-il encore le rappeler ?), des ensembles de traits qui, comme les constellations, ne valent que depuis le point d’où ils sont réunis. Elle catégorise les êtres humains et les hiérarchise en assignant identités et différences. Identifier des races a toujours servi à se reconnaître et à se séparer : la théorie de la race est intrinsèquement raciste et ségrégationniste. Loin d’être le moteur de l’histoire elle a toujours servi à justifier l’état de fait présent (l’esclavage par exemple) et intervient pour renforcer le pouvoir dans des moments de crises économiques ou idéologiques. Aujourd’hui, instiguer ou accompagner son ressurgissement est une lourde responsabilité.
Elle est intrinsèquement raciste et ségrégationniste y compris quand elle se prétend une « construction sociale », comme le théorise par exemple Saïd Bouamama qui introduit une possible variation par rapport aux identités préassignées en proposant de considérer qu’on peut « se blanchir » et le PIR affirme, comme pendant à cette assertion, que « des blancs [des quartiers populaires] sont partiellement indigénisés »[16]. On redécouvre la poudre, le fil à couper le beurre, le racisme et les classes sociales, et on impose ainsi sur toute réalité sociale et politique la marque de la race. La race semble alors s’émanciper des critères biologiques qui ont fait les débuts de son succès, en fait elle s’épanche, jusqu’à englober en quelque sorte une déterritorialisation de la classe qu’elle reterritorialise. Se constitue ainsi une tendance du courant racialisateur, qui mélange différemment les composants : moins de couleur, plus d’origine sociale, toujours beaucoup de communautarisme culturel et religieux. La race est bien leur propre construction idéologique, et non cette « construction sociale » qu’ils prétendent déconstruire. Et la question devient alors : quel intérêt de classe peut on trouver à se vivre comme une race ?

Une belle illustration du fait que, même à l’époque où la race s’appuie sur la biologie, elle est déjà une construction politique et sociale
Elle est intrinsèquement raciste et ségrégationniste y compris quand elle adopte un vocabulaire moins ouvertement raciste. Ainsi les néologismes à la mode subtilement dérivés de la race ne sont que des déclinaisons qui avèrent son bienfondé théorique. Il suffit pour s’en rendre compte de voir à quel point ils sont compatibles avec la notion d’origine, comme dans ce texte qui glisse de « racisés » à « race » sans aucune rupture. Le terme « racisé » d’ailleurs en est précisément un bon exemple. En adoptant le point de vue du « ressenti » (ce qui est aussi un mode de dépolitisation très conforme à l’époque, le ressenti étant au fond individuel et impartageable, à part sous la figure de la victimisation), il prétend ne pas avérer la race comme une vérité. Il signifierait donc non pas « qui appartient à une race particulière » mais « qui ressent et/ou subit du racisme » donc l’assignation à une race particulière, puisqu’on subit en fait selon cette lecture non pas « du racisme » mais « un des racismes » : le terme « racisé » est en fait immédiatement essentialisant. Ainsi, Sihem Assbague donne la définition suivante de « femmes racisées » : « ce sont les femmes victimes de racisme donc les femmes non blanches ». On voit comment le glissement est immédiat du ressenti à l’identité affirmée, ou assignée. D’ailleurs on peut sans doute voir dans le passage de « race » à « racisé », l’évocation de ce que Norman Ajari nomme le passage nécessaire de « la race en soi » à « la race pour soi, politisée et organisée »[17], soit deux déclinaisons complémentaires de la race, entre lesquelles on voudrait bien ne pas avoir à choisir. Ainsi ce n’est jamais à la place de « race », que ces termes sont utilisés, mais leurs usages lui sont toujours associés, l’un menant à l’autre comme dans ce texte. On utilise à la fois « race », « racisé », « racisation », « racialisé », et on affuble le nom des dites « races » ressenties et réalisées de majuscules. On partage le monde, en assignant positivité et négativité de manière systématique : voilà comment, en toute bonne conscience, chacun peut en venir, dans ce qu’on pourrait appeler un racisme « par en bas », à se faire sa petite taxinomie des races et à trouver, à chacun, sa case. On peut par exemple se demander tranquillement si les juifs sont à classer dans les blancs ou pas, et considérer que oui (forcément…).
Par ailleurs, quand le terme de « racisé » est employé, il est entendu que c’est un agent quelconque qui « racise », c’est un processus qui se joue contre le sujet « racisé », à son corps défendant. Or ici, on se définit ainsi de manière permanente, dans aucun cadre d’interaction : on choisit ce qu’on constitue ainsi en identité, on assume « la race pour soi » qu’on porte en sautoir, comme d’autres des médailles[18]. Fière de sa condition, la victime tient sa revanche, le ressentiment gonflé à bloc. Elle peut ainsi pérorer et faire la morale. Pire : non seulement c’est ainsi qu’elle se définit, mais surtout c’est ainsi qu’elle va définir les uns et les autres. Elle prend le pouvoir sur l’identité, et règne sur les assignations. Elle gère la frontière symbolique de ce qu’elle construit comme étant le bon ou le mauvais côté et met tout le monde en cage. Celui-ci n’est pas blanc, il est discriminé, dominé, une victime, celui là l’est, c’est un privilégié, dominant, un bourreau sans doute. Au-delà de l’affligeant exercice, plus loin qu’une passion triste, fabriquer des identités constitue un mécanisme de pouvoir énorme. Les risques pris par qui joue ainsi les apprentis-sorciers ne sont pas des moindres : qui peut être certain de pourvoir maîtriser dans la durée ce qu’il aura invoqué ? Voilà comment on se retrouve à devoir se défendre de ne pas tremper les doigts dans le même court-bouillon que l’extrême droite. Assigner les identités, bétonner des subjectivités, figer ici et là dans des portraits racialisés, donc racistes : on voudrait exacerber des formes diffuses de fascisme de basse intensité et préparer le terrain à leurs bataillons qu’on ne s’y prendrait pas autrement.
On peut sans doute dire d’ailleurs que la joie avec laquelle nos racialisateurs et nos genristes se repaissent des identités fixes est l’inverse du choix de prendre le parti des devenir minoritaires. A partir des catégories qui promettent justement un tel devenir émancipateur et capable de subvertir la figure majoritaire, aux femmes et aux immigrés par exemple, on propose là une territorialisation ferme, on promeut l’exercice d’un pouvoir effectif à une petite échelle, via une opération qui transforme des potentialités de contestations en assignations victimaires. Chaque forme avec laquelle l’hybridation subversive pouvait advenir devient par là désamorcée et enfermée dans une identité assignée et close, dans un désir impuissant de devenir majoritaire. Alors pourquoi tomber dans un tel gouffre de la pensée ? Pourquoi s’encombrer d’une grille théorique aussi vaseuse que nauséabonde ?
Le recours à cette grille de lecture semble se justifier d’abord dans le texte parce qu’elle permettrait de « visibiliser » et de dénoncer le racisme de la « gauche blanche ». C’est même l’occasion d’un court panégyrique du PIR, très probablement mensonger : « Voilà pourquoi nous étions enthousiastes devant l’énorme travail qui a rendu visible ce racisme de gauche, républicain, auquel le Parti des Indigènes de la République (PIR) a participé depuis 2004 », mensonger parce que justement c’était bien plutôt la consternation qui était généralisée pour qui se retrouvait confronté aux premières propositions du Mouvement des Indigènes de la République, heureusement très confidentielles (après un appel de lancement médiatique qui, sûrement pris pour une pétition, a reçu son lots de signatures de politiciens et d’associatifs en mal d’engagement de papier). C’était le même constat du ridicule d’un discours tenu à la place des autres, victimisant, finalement raciste, avec une « inversion du stigmate » tellement mal pensée qu’elle rejouait de manière très apparente les écueils du discours dénoncé. Personne, et évidemment aucune « féministe matérialiste », à part peut-être Christine Delphy (dépositaire de la marque), ne pouvait s’enthousiasmer devant un tel salmigondis.
Ce racisme de la « gauche blanche » devient même ici l’explication voire la cause des attentats de Charlie Hebdo (qui se retrouve promu quartier général de la triple oppression) et de leurs suites, présentés comme un retour (toujours bien mérité, non ?) du refoulé que « la gauche s’est pris en plein dans la figure ». Dans un déni de l’événement commun d’ailleurs à une partie de cette gauche et de son extrême, ces attentats pourraient donc être considérés comme un acte anti-raciste (si la tuerie de Charlie Hebdo répond au racisme de la « gauche blanche », les attentats contre le super marché casher seraient-ils une réponse au « philo-sémitisme d’état » dénoncé par Houria Bouteldja ?).
Mais, la « gauche blanche », en fait, c’est de quelle couleur ?
Venons-en donc au fond. (Re)mettre en œuvre la théorie de la race (à nouveau en fait, puisque la manœuvre a déjà été poussée assez loin avant qu’on cesse de réfléchir avec cette notion moisie, voir illustrations) serait donc nécessaire pour dénoncer le racisme de la « gauche blanche » et du « féminisme blanc » (sinon, on se le prend « en pleine figure » comme au jokari, et ça fait mal). On peut même dire que, en dépit de la violence avec laquelle les uns et les autres se tirent dans les pattes, la désignation de cette cible cimente l’aire racialisatrice sur laquelle plusieurs tendances émergent, le PIR, mais pas seulement, Saïd Bouamama, fondateur et principal animateur du « Front uni des immigrations et des quartiers populaires » (d’ailleurs co-organisant et participant à des débats publics en compagnie du formidable Michel Collon, et publiant régulièrement sur son site campisto-confusionniste[19]) et son entourage, la revue de « théorie marxiste en ligne » Période, la revue Poli, et d’autres, dont apparemment les auteures de ce texte).
Quelques remarques s’imposent à ce propos. Pour commencer on ne voit pas bien à quoi vient s’opposer le « blanche » de « gauche blanche », à quoi cela sert de qualifier la gauche (mais laquelle ?) de « blanche », si ce n’est pour prouver, une fois de plus, que les termes du débat seront racialisés ou ne seront pas. Y aurait-il alors une « gauche noire » ou « jaune », nos racialisateurs seraient-ils prétendant à être la « gauche de race » ou la « gauche-quelque-chose » ?
Par ailleurs, on peut remarquer que cette focalisation sur l’attaque de la gauche ne leur est pas propre. Une série de réactionnaires, ou de proto-fascistes en font aussi leur fonds de commerce, de Soral, à Finkielkraut, en passant par Onfray, Michéa et tout un courant anti technologie, fustigent eux aussi, pour des raisons qui peuvent sembler différentes, la dite gauche, le plus souvent d’ailleurs pour le même genre de raisons, par exemple pour ce qu’elle proposerait de permissivité, d’« esprit de 68 », de pédagogie trop centrée sur l’intérêt des enfants, de multiculturalisme et de métissage, d’intérêt trop charitable pour la situation des sans papiers, etc. Cette opération se fait souvent en brouillant les pistes de l’origine idéologique des discours, ainsi Michéa prétend critiquer le « sans papiérisme » depuis un vrai point de vue de gauche (entendu comme les vraies racines du marxisme, les vraies origines, toujours le « retour aux sources »), comme Etienne Chouard, quand il affirme que les antisémites sont les vrais anti-fascistes et vice versa[20].
Bref, le sillon de la confusion se creuse, ce qui, vu la conjoncture, ne présage rien de bon. Ici, on se sert donc de la théorie de la race pour accuser la gauche de racisme.
Des lendemains qui gèrent…
Pour notre part, et sans souscrire à cette manie du « point de vue situé », on peut dire que, conceptuellement et bien souvent pratiquement, nous nous sommes opposés à la gauche réelle, telle qu’elle est, plus ou moins plurielle, gestionnaire, socialiste ou communiste, verte, rougeâtre ou rose, selon les échelles, les époques, les alliances gouvernementales, les détenteurs du pouvoir politique institutionnel. Nous ne nous sommes, par ailleurs, contrairement à la revue Vacarme par exemple, jamais vécus comme « étant la gauche », ce qui renvoie plutôt pour nous à une aspiration à participer à cette gauche gestionnaire qui, de fait, donne une grande partie des inflexions idéologiques à la gestion de l’Europe depuis plusieurs dizaines d’années maintenant, et que l’on peut même considérer comme le moteur intellectuel et le commandement pratique du Capital, que ce soit dans les instances de pouvoirs administratifs ou dans les divers lieux actuels de production. Nous n’avons jamais entretenu non plus cette illusion sur le vote qui en ferait un moyen d’expression politique pertinent et qui donnerait du crédit à la représentation électorale. Nous n’avons jamais appelé à « occuper le vote », ni trouvé ça drôle[21]. Lorsque nous nous opposons à la gauche, ce n’est pas avec cette haine soudaine des anciens amis, la haine des espoirs déçu, la haine que voue le trahi à celui qui l’a floué. Il semble bien que ce soit cette haine passionnelle que le courant racialisateur, largement composé de ces « gens de gauche », post-staliniens ou pré-socialistes, travailleurs de l’associatif, pacificateurs des quartiers ou de la culture, lui vouent, une haine projectionnelle, une haine liée au fait qu’elle représente trop mal les espoirs qu’on avait fantasmé, les désirs qu’on lui avait confié : une haine, encore une fois, sans aucune autonomie. On est bien loin de cette froide haine de classe des prolétaires du commun. Ce que nous avons à reprocher à la gauche, c’est ce qu’elle dit et ce qu’elle fait, pas ce qu’elle n’a pas fait, pas ce qu’elle devrait dire. Pas ce qu’elle a promis et pas réalisé. S’il faut attaquer la gauche, ce n’est pas qu’elle serait « blanche » ou « raciste », c’est parce que ça fait longtemps qu’elle ne construit rien d’autre que des lendemains qu’elle gère, tout en assurant, au jour le jour, le gouvernement de nos existences.
Sur les pieds des stals
On prétend aussi, de manière complémentaire à l’attaque de la « gauche blanche », prendre comme cible le « mouvement ouvrier blanc », qui aurait « invisibilisé », deux questions : les questions de genre et de race. On peut répondre d’abord, au delà du refus de la généralisation de l’usage de cet épithète, que ce qu’on peut appeler le « mouvement ouvrier », s’il a pu être selon les lieux, les époques et les luttes, syndical, co-gestionnaire ou gestionnaire, travailliste, réformiste, contre-subversif, anti-révolutionnaire, etc, n’a jamais été « blanc ». Ce que nos racialisateurs de gauche critiquent dans le « mouvement ouvrier blanc », ce n’est qu’un regard déjà périmé depuis longtemps sur le mouvement de la lutte des classes, un mauvais zoom qui ne sélectionne que ce qu’il est capable de voir, c’est-à-dire l’orthodoxie la plus éloignée de ce qui fait justement l’intérêt du « mouvement ouvrier » en question. Ce que cette focale bidon empêche de discerner, c’est justement le fait que la figure majoritaire de l’ouvrier masculin, d’origine nationale, fier de son travail (figure co-produite par le patronat, le PCF et la CGT) a été déjà largement contestée, dépassée, débordée par ses marges (pas au sens numérique) : les immigrés, les femmes et les jeunes et autres figures marginales l’ont renversée. C’est dans les années 70 que, de son piédestal, elle est tombée sur les pieds des stals, avec les fortunes et les infortunes que qui s’intéresse à cet aspect de l’histoire des luttes peut utilement chercher à comprendre. Prétendre imposer aujourd’hui, à coup de race, la place des « racisés » dans le « mouvement ouvrier blanc », c’est refuser cet héritage. En niant que la bataille a déjà été menée et gagnée, on ignore la critique mise en œuvre par « les premiers intéressés » — auxquels on ne s’intéresse que quand on y a intérêt —, on fait bégayer l’histoire pour le pire, en transformant un mouvement émancipateur déjà advenu (marqué par la sortie de l’usine et de l’idéologie du travail par exemple) en lecture inactuelle moralisante.
C’est, à proprement parler, se faire les porteurs d’une fausse nouvelle qui ne peut concerner que celui qui serait resté à l’ère du PC triomphant ou qui en aurait encore les raisonnement et les manières de voir — la nostalgie ? —, celui qui n’aurait rien appris des années 70 : ce point de vue ne fait la leçon qu’à soi-même. Ce qu’il indique c’est surtout un regard très orthodoxe, normatif et majoritaire, « blanc », si on va par là.
En arrêtant de prendre un kaléidoscope de Pif gadget pour une longue vue, on pourrait constater que ce à quoi nous ramène par exemple la situation des migrants de la chapelle, ce n’est pas à une quelconque « question raciale », utile pour culpabiliser « le mouvement ouvrier blanc », mais c’est bien plutôt à cette histoire de lutte des immigrés qui va des grèves d’usines à Margoline, à Pennaroya et ailleurs au mouvement des sans papiers de 96, en passant par les grèves de la faim pour la régularisation dans le courant des années 70, les grèves de loyer des foyers Sonacotra, et qui poursuit l’affirmation comme sujet de lutte des travailleurs immigrés avec tous ceux qui se sont battus à leur côté dans les luttes ouvrières des années 70. Ainsi la critique ne relate-t-elle que l’image déformée projetée sur le dit « mouvement ouvrier », autrement dit, la calomnie en dit plus long sur le calomniateur que sur le calomnié. Tout en faisant carrière à l’université, le racialisateur combat ses propres fantômes, le devenir du mouvement de la lutte des classes, comme son passé lui restent strictement et heureusement étrangers.
Ad absurdum
D’ailleurs, travaillons le jeu intellectuel, suivons par l’imagination le chemin proposé, parcourons le plus avant. Mettons donc de côté le fait qu’une lecture raciale est une lecture raciste et la nausée qui vient, mettons de côté le projet politique que les banalités qui se font passer pour des découvertes impliquent, mettons de côté le fait que cette manière de voir le monde (et comme chacun sait le monde nous le rend bien : comme on le regarde, il nous regarde aussi) vient des États-Unis, et de l’université américaine, et que ce n’est pas le meilleur, ni de l’un ni de l’autre. Mettons de côté alors cette ultime facétie de l’anti-impérialisme. Mettons de côté donc d’où ça parle et où ça va. Admettons que tout nous ramène à la race. Plongeons dans la dystopie racialiste et imaginons que la situation soit telle qu’elle est décrite là. Supposons même que cela ne soit que la face émergée de l’iceberg. Admettons donc que le racisme soit un système qui fait tourner le monde et avancer l’histoire, et que nous soyons tous adéquatement définis par une race à laquelle nous appartiendrions. Allons plus loin dans l’espèce d’enquête ouvrière proposée dans le texte. On verra alors que prendre le métro régulièrement, passer même éventuellement le périph (prendre le métro, c’est intéressant, mais la question reste de savoir dans quel sens et pour quelles raisons…), le faire même tous les jours, lire de mauvais articles de collègues ou d’homologues, participer à des colloques, et même aller à une manifestation pro-palestinienne à Barbès, ne suffisent peut être pas à saisir ce qu’un travail précis et approfondi permettrait alors de mettre à jour. Admettons donc que la situation soit dix fois pire que telle qu’elle est présentée, qu’elle soit plus ségrégationniste encore que ce qu’on peut s’imaginer de ce qu’a pu être la situation américaine, que tous les éléments de langage et ce qu’ils peuvent emporter de réalité soient tombés sous l’empire de la race.
Et alors, serait-ce une raison pour penser avec ce cadre-là ? Une perspective émancipatrice quelconque pourrait-elle en sortir ? Quel est l’enjeu, après tout ? Le travail des matérialistes serait-il donc de faire un mauvais instantané à prétention scientifique, se targuant d’objectivité, d’une situation si merdique ? Doit on y plonger jusqu’à y boire la tasse, s’y rouler, ou doit-on plutôt chercher par quelle voie en sortir ? Pour citer un matérialiste célèbre, qui ne s’est pas précipité à son époque pour hurler avec les chiens de la race, « les philosophes n’ont fait qu’interpréter le monde de différentes manières, ce qui importe c’est de le transformer ». Si nous partageons cet objectif, transformer le monde, faire la révolution, est même la seule perspective intéressante dans laquelle on peut chercher à l’interpréter. Et là, qu’est-ce que ça donne ? Par où ça passe ? Par où la subversion peut-elle se frayer un chemin ? Certaines expériences de lutte, un peu de réflexion sur l’histoire des mouvements prolétariens, en particulier dans les périodes les plus mouvementées, ainsi que quelques lectures ont pu nous apprendre que la lutte ne se construit pas en épousant en creux le mécanisme auquel on cherche à s’opposer. Autrement dit, il y a des évidences étonnante : l’instituant n’est jamais l’inverse de l’institué. Aucune binarité, aucune opposition en miroir, symétrique ou même mimétique ne subvertit rien. Pour subvertir et révolutionner il faut inventer, il faut se trouver dans un ailleurs conflictuel au système contesté.
Alors, quelles sont les pratiques possibles et proposées par cette racialisation tous azimut ? Formellement aucune. Si on y regarde de plus près et qu’on dépasse l’observation sociologique, un ensemble de micros pratique, pour l’instant plutôt à usages internes : assignation identitaires des uns et des autres, ségrégationnisme mou, projections communautaristes, et tout ce que cela charrie de culpabilisation et de police des comportements.
We would prefer not to, n’insistez pas !
Le seul horizon que ce choix de lecture peut ouvrir serait la constitution d’un « sujet de race », le « racisé » par exemple, qui devrait mener, si tout fonctionne, à la « guerre des races ». C’est aussi à cette perspective de « lutte de race » qu’on nous agite comme une promesse à la fin du texte, que nous nous opposons ; et c’est vital.
N’étant pas de ceux qui trouveraient sympathique de priver César de ses lauriers, nous devons reconnaître, à notre tour, que nous avons été très « enthousiastes » devant tout ce que l’article Pour une approche matérialiste de la question raciale a « rendu visible » – mais est-ce bien volontaire ? – et nous espérons avoir aidé à en saisir des aspects restés peut-être obscurs au lecteur distrait. En un même élan, cet article aura permis de cerner l’indigence intellectuelle d’un certains nombre de producteurs de discours, « matérialistes » compris, les gloses verbeuses de ceux qui prennent comme caisse de résonance la philosophie au ventre creux, l’ignominie de certaines catégories de pensées – celle de « race » en particulier – et l’impasse absurde de leur utilisation, mais aussi l’inanité d’un certain type de revues et des postures éthiques qu’elles génèrent, et enfin, last but not least, les méfaits sévères que peut engendrer la théorie sans autre pratique, la théorie comme pratique unique et séparée.
Face à cette opération de promotion de la mise à jour très universitaire d’un poussiéreux marxisme « articulé » à une théorie de la race relookée, il est urgent de réagir. La racialisation parée des atours du matérialisme est un monstre dont la diffusion hors des laboratoires – de recherches – où elle est née, dans le contexte de crise actuel, en appuyant ainsi sur les projections ségrégationnistes, le ressentiment et la victimisation, serait une véritable catastrophe. Ce sont de lourdes responsabilités que contractent ici ceux qui y contribuent, que ce soit par conviction raciste (ça existe aussi), par légèreté conceptuelle ou simple opportunisme carriériste. Contrairement aux auteures de ce texte, refusons le dialogue avec les racialisateurs : les voies de l’émancipation sont autres, c’est ailleurs que se joue la question de l’opposition au système capitaliste et à l’exploitation qu’il organise. Il est plus que temps de rompre avec ces archaïsmes et de réaffirmer que c’est bien la lutte des classes le moteur de l’histoire. C’est à cette condition qu’on pourra commencer à se donner les moyens de l’autonomie politique et pratique nécessaires à la construction de toute perspective révolutionnaire.
Le refus qui se formule ici entend s’ouvrir comme un chantier. En attendant des luttes plus fécondes et d’être portés par des mouvements de conflictualités massifs, il nous faut nous atteler à combattre ces propositions et ce qu’elles entrainent. Que ceux qui refusent la racialisation – que d’autres s’échinent à faire advenir – manifestent leur opposition, et que des interventions (discussions, textes, etc) polarisent ces refus, posent et travaillent des arguments, dont certains ici ne sont qu’esquissés, ébauchés ou manquent.
Notes :
1 – Les mots sont importants, lmsi.net, site internet animé par Sylvie Tissot et Pierre Thevanian, vieux compagnon de route de la racialisation et producteur logorrhéique de textes.
2 – « Revendiquer un monde décolonial », entretien avec Houria Bouteldja, réalisé par Caroline Izambert, Paul Guillibert et Sophie Wahnich, Vacarme n° 71, printemps 2015, pp. 44 à 69, http://www.vacarme.org/article2738.html.
3 – La revue Vacarme a été diffusée plusieurs années via les éditions Amsterdam, qui avec les prolifiques et néanmoins chics éditions La Fabrique, sont les principaux promoteurs et diffuseurs des textes du PIR et de ses quelques semblables (malgré des efforts soutenus, les éditions Syllepses concourent dans une autre catégorie).
4 – « Nous sommes la gauche », appel à l’initiative d’Act Up publié en 1997 dans différents journaux, republié dans Vacarme n°56, été 2011, pp. 64 à 66, http://www.vacarme.org/article2059.html, la revue en était, à l’époque, signataire.
5 – Voir le déjà chouette dossier : « Dammarie-lès-lys : les militants de l’incertitude », en particulier l’avant propos d’Emmanuelle Cosse et Fabien Jobard, et « La puissance du doute » par Fabien Jobard, in Vacarme n°21, Automne 2002, pp.14 et sq, http://www.vacarme.org/rubrique94.html. On n’a pas peur de trancher dans ce dossier en prenant le parti de la pacification contre l’émeute.
6 – On peut repenser ici à la manière dont Pierre Vidal Naquet distingue répondre à quelqu’un, ce qui signifie entrer en dialogue et répondre à ce qu’il dit, c’est-à-dire contrer son discours. Dans l’avant propos de Les assassins de la mémoires, « un Eichmann de papier » et autres essais sur le révisionnisme, 1991, La découverte, p.9, il affirme à propos des négationnistes : « J‘ai parlé de répondre à une accusation. Qu’il soit entendu une fois pour toutes que je ne réponds pas aux accusateurs, que, sur aucun plan je ne dialogue avec eux. Un dialogue entre deux hommes fussent-ils adversaires suppose un terrain commun, un commun respect en l’occurrence de la vérité. (…) ».
7 – « Vacarme critique les Indigènes : la faillite du matérialisme abstrait », Norman Ajari, publié sur le site du PIR le 12 juillet 2015.
8 – Le « phénomène social » dont il est là question aurait-il un lien de parenté avec « l’indigène sociale » dont il a été question plus haut ? Notons en tout cas qu’ils portent le même nom de famille.
9 – « Des morts en Méditerranée en passant par les émeutes de Baltimore jusqu’aux menus faits quotidiens de la vie métropolitaine, tout nous ramène à la question raciale. » Et c’est plutôt chouette, non ?
10 – http://www.washingtontimes.com/news/2015/apr/29/baltimore-riots-sparked-not-by-race-but-by-class-t/
11 – Photo légendée ainsi : « Manifestants juifs à Baltimore le 3 mai 2015, après la mort de Freddie Gray ».
12 – A propos de l’usage de « métropolitain » : vu qu’il ne s’agit sans doute pas d’un terme vintage pour désigner le métro, même s’il est un puissant outil d’analyse de nos matérialisées, le terme joue sans doute en écho de la référence à l’imaginaire colonial, tout en désignant explicitement l’ennemi actuel de certains militants ardents défenseurs des villages et des arrières mondes, du petit, du « maîtrisable » : la métropole, construite comme symbole de la concentration urbaine et incarnation des « grands projets » qui seraient le lieu nodal du développement capitaliste.
13 – « Ce racisme intégral, pour reprendre l’expression de Franz Fanon, consubstantiel à la société française, commence dès l’orientation en 4ème, avec la recherche d’un stage, du premier job… » nous dit le texte. Frantz Fanon se trouve être actuellement une des références commune du pôle racialisateur.
14 – Revue de « théorie marxiste en ligne » produite par les organisateurs des séminaires « Penser l’émancipation », porte voix de la racialisation, parmi eux figurent des grosses têtes vides de l’université pleines d’idées creuses et de vent mauvais et les petites mains en chef des éditions la Fabrique, auteurs de Féministes blanches et l’empire, dont le design mérite d’être salué voir sur http://lemoinebleu.blogspot.fr/2013/07/aspects-de-la-gentrification.html. Ces happy fews de la race relatent avec une certaine naïveté comment ils ont reçu la révélation : « C’est alors que d’autres militants ont avancé une idée aussi percutante qu’audacieuse, particulièrement précise et stimulante comme point de départ à tout débat sur la race et le racisme : ”La voie vers la déracialisation passe par la race” ». The way to non-racialism is through race : en anglais, c’est vraiment chouette aussi.
15 – Le texte prend d’ailleurs à ce sujet les patins de cette défense aujourd’hui répandue de l’Islam comme « religion des dominés », impliquant qu’il n’y a pas de critique possible du fait religieux à son encontre, ce qui est bien peu marxiste, sauf à suivre les manipulations de Thévanian pour rendre Marx compatible avec la défense de la religion, voir la précise et pertinente critique de Germinal Pinalie « Les mots de Marx sont important, sur La haine de la religion de Pierre Thévanian », https://blogs.mediapart.fr/blog/germinal-pinalie/100613/les-mots-de-marx-sont-importants-sur-la-haine-de-la-religion-de-pierre-tevanian. On aura, là encore, une illustration concrète du bon ménage que peuvent former la saloperie conceptuelle et la malhonnêteté intellectuelle.
16 – Référence tirée du site du PIR, rubrique Nos principes.
17 – Norman Ajari dans la réponse du PIR à ce texte.
18 – Dans les premiers paragraphes du texte, c’est au titre de « descendantes de musulmans et de juifs d’Algérie » qu’on parle, qu’on justifie la nécessité de mener la critique du PIR et de la « Gauche », c’est en fait à ce titre (dans un fourre tout qui mêle encore origines nationales, communautaires et religieuses, que peut-on bien faire, par exemple, des algériens juifs ou pas, athées et/ou communistes ?) qu’on veut infléchir un changement de direction au courant racialisateur. On ne sait plus alors, entre « la racialisation que nous subissons » et cette manière de se définir positivement, s’il s’agit de racialisation « par choix » ou « par nécessité ».
19 – Collon étant lui même très peu éloigné de certains négationnistes et de pleins d’autres gens formidables comme lui, voir à ce sujet http://confusionnisme.info/2014/12/23/sinformer-sur-michel-collon/ et http://confusionnisme.info/2014/12/23/michel-collon-un-militant-de-la-confusion/ et autres.
20 – http://www.parasite.antifa-net.fr/monolecte-etienne-chouard-et-les-vrais-antifa/
21 – « Occupons le vote », Vacarme n°8, hiver 2012, p.1 à 39, http://www.vacarme.org/article2110.html.
En fouillant dans les poubelles de l’histoire, on ne trouve pas que des trésors : faisons rentrer la race dans le trou d’où elle n’aurait jamais dû être ressortie. Et gageons que les luttes d’émancipations et les perspectives révolutionnaires futures dispersent aux 4 vents les racialisateurs et le monde qui les a produit.